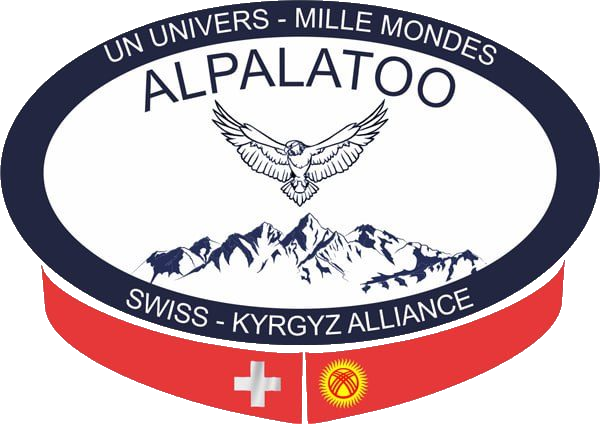À l'âge de 22 ans, mon père, orphelin de père et de mère, originaire de Versoix, travaillait comme jeune banquier dans une banque genevoise. Malheureusement, cette dernière fit faillite, le contraignant à chercher un nouvel emploi. Passionné par l'économie, il lisait régulièrement le Journal du commerce et de l'industrie, la référence pour ceux qui étaient déjà dans les affaires ou souhaitaient s'y lancer. C'est ainsi qu'il trouva une annonce pour un poste en Valais, près de Martigny. Martigny, qui marque l'entrée dans le Valais lorsqu'on regarde une carte de géographie, se situe après Villeneuve, au bord du lac, et Saint-Maurice, cette petite cité qui abrite une grande école catholique. Mon père y trouva un emploi passionnant : il était chargé d'un bureau de recherches sur l'existence de mines de charbon dans la région. On croyait en effet que le Valais pouvait contenir des réserves exploitables, ce qui aurait pu bouleverser l'économie suisse, un pays dépourvu, à l'exception de l’eau, de matières premières. Celle-ci est exploitée pour produire de l'électricité grâce aux nombreux barrages hydroélectrique sédifiés à travers le Valais et les Alpes. Avant l'avènement des centrales nucléaires, qui restent peu nombreuses en Suisse (deux actuellement, qu'il faudra sans doute mettre à l’arrêt et construire de nouvelles centrales. Après quatre années de recherches intensives, il s'avéra que les mines tant espérées étaient illusoires. On creusa, on chercha, mais on ne trouva jamais de "charbon exploitable ». Mon père fit alors deux choses essentielles durant cette période: il s'investit pleinement dans cette mission inédite pour lui et, surtout, il rencontra ma mère, une jeune Valaisanne catholique.

Rencontres, foi et ambitions coloniales
En Valais, la foi catholique est très ancrée, tandis que mon père était un protestant convaincu, issu d'une famille d'origine suisse-allemande, de l’Emmenthal et mon grand père paternel s’est installé à Versoix en 1856.
Avec l'échec du projet minier, mon père dut chercher une nouvelle orientation professionnelle. Une annonce dans le Journal du commerce et de l'industrie attira son attention : « une grande maison de négoce recherchait des jeunes Suisses, formés au commerce et à la comptabilité, pour devenir inspecteurs en Afrique ». Il postula et fut retenu pour une mission de 18 mois. À cette époque, on ne prenait pas encore l'avion pour se rendre en Afrique : le voyage se faisait par bateau, depuis Marseille. C'est ainsi que mon père partit pour Le Cameroun, puis la Côte d’Yvoire, territoires de « l’Empire colonial français ». Mon père, qui n'avait rien d'un «colonialiste », fut fasciné par ce monde inconnu. Son nom, Ramseyer, appartient à une lignée de paysans de l'Emmenthal, dans le canton de Berne. Sa famille, très protestante, avait donné de nombreux missionnaires en Afrique : au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gold Coast (actuel Ghana).
Aujourd'hui encore, à Accra, on trouve une statue d’un missionnaire portant le nom de Ramseyer. Ces missionnaires apportèrent le christianisme sur ces terres. Mais était-ce vraiment une bonne chose ? N'aurions-nous pas mieux fait de laisser les peuples africains développer leur propre philosophie et leur propre culture ? Les Européens ont toujours cru en leur supériorité, en leur mission civilisatrice, mais force est deconstater que cette période fut aussi marquée par de nombreuses erreurs. Beaucoup de pays colonisés ont rencontré de graves difficultés de développement après leur indépendance. Certains, notamment en Asie, possédaient déjà des civilisations aussi anciennes que les nôtres, souvent plus « sophistiquées ».
Une attente longue et un enracinement à Versoix
Pendant huit ans, de séjour en Afrique de mon père, ma mère dut attendre son fiancé avant qu'il ne l’épouse- incroyable, mais vrai!. Ce fut long pour l'époque : à 31 ans, une femme non-mariée était considérée comme une "vieille fille". Pourtant, ils s'aimaient et mon père lui promit une vie stable. C'est ainsi qu'ils s'installèrent à Versoix, village d'origine des Ramseyer depuis 150 ans maintenant. Mon grand-père s'y établit en 1856. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Suisse était majoritairement rurale : 60 % de la population était paysanne. Ce mode de vie fut une force pour le pays, garantissant une stabilité économique et sociale. Les paysans jouaient un rôle crucial, notamment pendant les deux guerres mondiales, en assurant la production alimentaire du pays. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 4 % de la population, mais ils conservent une influence politique majeure, notamment à Berne, au Parlement. Mon grand-père faisait partie de cette paysannerie instruite. Il savait lire et écrire, et, en tant que protestant, la lecture de la Bible était une tradition quotidienne. Il eut sept enfants en 23 ans, et exerçait le métier de charron- métier, aujourd’hui disparu; il n’existe plus d’artisans fabriquant des roues de char. Les fêtes traditionnelles préservent encore « ces chars », mais la profession n'existe plus.

Une éthique de la simplicité et de la transmission
Ainsi, l'histoire de ma famille illustre à la fois la transformation du monde rural suisse et l'évolution de la société moderne. Ce passé nous rappelle l'importance des racines et l'influence persistante du monde agricole dans la culture et la politique suisse, même à une époque dominée par la finance et l'industrie. Avant, mon grand-père était charron. Il était non seulement un homme qui s'était cultivé lui-même, mais aussi quelqu'un qui avait le sens des affaires. Avec les moyens qu'il avait, il s'est installé à son compte. Dès qu'il a commencé à gagner un peu d'argent en fabriquant des roues de char, il a investi ses économies dans l'achat de 3 maisons dans la même rue, prévoyant ainsi un avenir plus sûr pour ses sept enfants. Pourtant, ils menaient une vie simple…
À la fin du XIXe siècle et au début du XX ème, en Suisse, on ne vivait pas de manière ostentatoire. Ce sont des valeurs qui, selon moi, se sont presque perdues aujourd'hui. Les jeunes veulent immédiatement acheter tout ce qui est à la mode, ils dépensent leur argent dès qu'ils en ont. Ma mère me le rappelait chaque fois que je rentrais à Berne après lui avoir rendu visite. Elle me demandait : "Est-ce que tu mets de l'argent de côté pour tes vieux jours ?" Car avant 1948, date d'entrée en vigueur de l’AVS - un des piliers de notre système de retraite - les gens épargnaient eux-mêmes pour leurs vieux jours. Aujourd'hui, rares sont ceux qui ont encore cette discipline…
Autrefois, on ne faisait pas de folies. On achetait des meubles, on les faisait repeindre, on investissait dans une maison, mais on ne partait pas en vacances. Les premières vacances en Europe ne sont apparues que dans les années 30. Avant cela, l'idée même de vacances n’existait tout simplement pas.
Une vie familiale tissée entre absence, amour et guerre
Je reviens à ma famille. Mon père, en épousant ma mère, a sans doute compris qu'elle était capable de mener une vie indépendante pendant des mois et de diriger seule son foyer. Nous avions une grande maison à Versoix. Sur les 27 ans qu'a duré leur mariage, ils n'ont vécu ensemble que pendant 12 ans, mon père étant souvent absent, au loin, en Afrique. Ma mère, bien que catholique à l'origine, nous a élevés dans le protestantisme, gérant seule la maison et notre éducation. Ma naissance a été une surprise. Ma mère avait déjà eu trois enfants, dont un, mon frère aîné, était mort en bas âge. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte de moi à 43 ans, elle n’était vraiment pas ravie. À l'époque, on considérait qu'avoir un enfant à cet âge pouvait donner naissance à un « idiot». Elle craignait donc pour mon avenir… Ma mère nous a élevés avec dévouement et un talent d’éducatrice. Chaque jour, après l'école, elle nous attendait avec un chocolat chaud et des tartines beurrées saupoudrées de sucre. Ensuite, elle nous aidait à faire nos devoirs. Elle m'a souvent dit qu'elle avait "refait toutes ses écoles avec moi". C'est ainsi qu'elle a enrichi sa propre culture. Plus tard, à l’adolescence, naturellement, j'étais plus autonome, mais son soutien constant avait déjà porté ses fruits. Chaque été, mon frère et moi passions un mois chez mon oncle Edouard et ma tante Céline, en Valais. Ils nous adoraient et nous apportaient un amour qui nous a donné une grande force intérieure. Je crois sincèrement que se savoir « aimé » permet de développer une assurance certaine de soi.

Concernant mon père, il travaillait pour une société commerciale de l'Ouest africain – La SCOA - fondée par deux Suisses, dont le siège était à Paris.
En septembre 1939, lors de la déclaration de guerre, il se trouvait avec nous dans notre maison de Versoix. Il se disait sans doute qu'il devait retourner à Paris pour aider en cas de besoin et rester solidaire avec l’entreprise pour laquelle il travaillait depuis presque vingt ans. La France venait de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie, mais les combats n'ont pas commencé immédiatement. Ce n'est qu'en mars 1939 que les hostilités se sont intensifiées. Ainsi, mon histoire familiale s'inscrit dans un monde qui a beaucoup changé. Les valeurs d'épargne, de travail et de modestie qui animaient mes parents et grands-parents semblent aujourd'hui s’être estompées. Pourtant, elles ont forgé mon identité et mon regard sur le monde. En mars 1940, Hitler et l'Allemagne ont d'abord attaqué la Hollande et la Belgique, qui sont rapidement tombées sous leur contrôle. L'Autriche, elle, avait déjà été annexée sans combat dans ce que l'on appelle « l’Anschluss".
Puis, les troupes allemandes ont pénétré en France. Cela mettait fin à ce qu'on avait appelé la « drôle de guerre », une période d'attente qui dura six mois. Dès février 1940, l'Allemagne avait envahi le Danemark, anéanti les Pays-Bas et la Belgique, et progressait vers la France. Le gouvernement français croyait pouvoir tenir, mais l'effondrement fut rapide…
« C’est ton homme qui est de retour»
Pendant ces événements, mon père, fidèle à ses idéaux, a décidé de se rendre à Paris pour aider la société pour laquelle il travaillait à organiser son repli avant l'arrivée des nazis. À ce moment-là, personne n'imaginait que la France tomberait aux mains des Allemands en seulement cinq semaines. Mais lorsque les chars allemands ont atteint la banlieue parisienne, ce fut la panique : un exode massif a commencé. Paris comptait alors environ un million d'habitants, et une grande partie de la population, y compris les habitants de la banlieue, va fuir vers le centre et le sud du pays. Mon père, lui, étant en séjour à Paris, a pris délibérément part à cet « exode ». Avec plusieurs camions, il aidait à transporter les documents et le matériel de son entreprise-La SCOA- espérant tout sauver avant l’arrivée des troupes allemandes. Mais le chaos était total. L'exode a duré environ une semaine, au cours de laquelle des milliers de personnes ont perdu la vie sous les bombardements allemands. La situation était désastreuse : il n’y avait rien à manger, les routes étaient encombrées, et les réfugiés étaient très vulnérables aux attaques. Mon père a perdu près de 10 kilos durant cette fuite. Finalement, il s’est retrouvé à Saint-Amand-Montrond, au centre de la France,où il a assisté à la signature de « l’armistice » et à la défaite des troupes françaises. Pendant plus de trois ans, il est resté bloqué en France. Pourquoi n’avait-il pas pu rentrer en Suisse, alors qu'il était Suisse, en possession d’un passeport suisse et ayant accompli son service militaire? Je ne le sais pas exactement. Mes parents ont alors vécu séparés, n’ayant que l’échange de lettres, d'ailleurs censurées par l’Occupant, pour communiquer. Il n’yavait pas vraiment de téléphone entre la Suisse et la France occupée, ce qui rendait toute communication encore plus difficile. En juillet 1943, mon père a décidé qu'il était temps de rentrer au pays. Son frère, qui était maire de Versoix, l’a aidé dans cette entreprise. Il s’est installé à Gex, en zone occupée, observant quotidiennement la rivière qui marquait la frontière avec la Suisse. Il se promenait, repérait les lieux, réfléchissant au meilleur moment pour traverser le cours de la Versoix. Puis, un jour de juillet, alors qu’il voyait des paysans récolter le blé sur l’autre rive, il a reconnu la ferme de la famille Lacroix, des amis de longue date. Ce fut un moment décisif… Avec son sac à dos contenant quelques affaires de rechange, il s'est jeté à l'eau et a traversé la rivière, trempé jusqu’aux os. Lorsqu’il est arrivé de l’autre côté, les paysans, surpris, lui ont demandé qui il était. Il a répondu : « Je suis Ramseyer de Versoix, je rentre chez moi. » Ils l’ont recueilli, l’ont aidé à se sécher, et il a immédiatement demandé à pouvoir téléphoner à ma mère. Lorsqu'elle a décroché, ma chère maman, il lui a simplement dit, avec humour : « C’est ton homme qui est de retour»
L’héritage de mes parents : amour, valeurs et transmission
À cette époque, nous étions plus ou moins les seuls ou presque du village à avoir un téléphone, ce qui a permis ces émouvantes retrouvailles. Ma sœur aînée et mon oncle sont immédiatement partis à vélo avec des vêtements secs pour mon cher papa. Entre-temps, mon père s’est présenté aux autorités suisses, et, trois jours plus tard, il a été convoqué pour accomplir son service militaire. À l’âge de 47 ans, il n’a pas été envoyé dans les montagnes, mais affecté à la surveillance des « prisonniers italiens » réfugiés et logés aux Pâquis, à Genève.
Ma mère, qui avait vécu seule avec nous durant ces trois longues années, a trouvé, il va de soi, un immense réconfort dans ces retrouvailles. Une fois par semaine, elle prenait le train pour Genève et passait la soirée avec lui. Plus tard, elle m’a confié que ces instants furent parmi les plus beaux de sa vie de femme et d’épouse.
Si je devais résumer mon enfance et l'influence de mes parents, je dirais que je n'ai pas eu ce que l'on appelle un "vrai papa".
Cependant, lorsqu'il était présent, il nous a apporté énormément. Il nous a éveillés à la Suisse, nous a initiés au protestantisme — bien que je ne sois plus croyant aujourd'hui - et surtout, il nous a enseigné l'importance de l’affection et de l’amour familial qu’il nous aura donnés constamment. Mon père a vécu une période marquante, notamment son retour d'Afrique et la guerre, qui l'ont tenu éloigné de nous pendant trois ans. Il était proche par le coeur et l’esprit, mais très loin de nous. Pourtant, il nous a transmis son amour profond pour la Suisse et nous a offert des bases culturelles très solides. Avec ma mère, nous écoutions la radio tous les jours à une heure précise, suivant les nouvelles avec attention de la guerre et l’après-guerre. Dès qu'il en avait l'occasion, mon père commentait l'actualité, partageant avec nous son savoir et sa vision du monde. Contrairement à ma mère, qui, bien que très vive d’esprit, n'était pas une femme de « culture classique », mon père était un homme qui avait voyagé et qui comprenait le monde. Ainsi, je dois à mon père une certaine discipline intellectuelle, mais tout le reste, je le dois à ma mère et à mes oncles et tantes du Valais. Ils nous ont offert une affection inébranlable et nous ont inculqué un profond sens du devoir familial, que nous avons su conserver. Ma sœur, aujourd'hui disparue depuis quatre ans à l'âge de 91 ans, mon frère de six ans mon aîné et moi, avons été élevés dans l'amour et le respect des autres. Nous avons toujours été conscients de la chance que nous avions, sans pour autant sombrer dans le «chauvinisme familial» . Nous étions reconnaissants d'être nés en Suisse, d'avoir des parents aimants et d'évoluer dans une sécurité relative grâce au travail de mon père et l’éducation que ma mère nous a donnée. Nous avions les moyens de vivre correctement, mais avec cela venait une responsabilité : le respect des autres. C'est une valeur que mes parents nous ont inculquée. Ma mère, en particulier, ne tolérait ni le mensonge, ni la délation. Elle tenait à ce que nous assumions nos actes avec honneur et vérité. Si un objet était cassé et qu'elle demandait qui en était responsable, «chacun doit être responsable de ses actes» disait-elle, et il était hors de question d’en accuser un autre.
Merci papa, merci maman!
Ces principes de base, bien qu'ils puissent sembler simples, ont forgé ma personnalité et ma vision du monde. Je ne prétends pas que ma personnalité soit parfaite, mais je suis infiniment reconnaissant d'avoir reçu ces valeurs fondamentales de mes parents.
Merci papa, merci maman! Mais mon merci le plus grand va à ma mère, qui a sacrifié toute sa vie pour nous élever et faire de nous des personnes respectables. Je ne sais pas si elle a réussi, mais je lui rends hommage aujourd’hui de tout mon cœur. Ma mère était et restera un exemple inestimable.