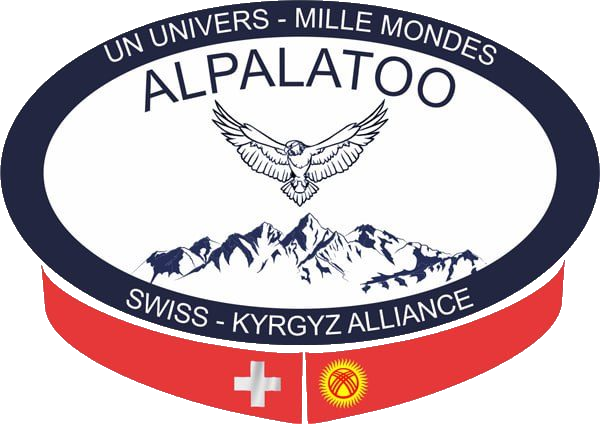Russie, Chine, Occident : la bataille invisible pour l’influence en Asie centrale
Jean-Paul Périat, consul Honoraire de la République du Kazakhstan en Suisse Romande :
« Moi, j’adore les pays russophones, leur culture, leur musique et leur littérature, et c’est pour ça que j’y consacre une grande partie de ma vie »
Passionné par les pays russophones et l’Asie centrale, l’auteur partage son parcours entre culture, affaires et diplomatie. De la Russie des années 80 au Kazakhstan moderne, il analyse les différences économiques, les influences régionales et l’importance de l’engagement et de l’ouverture d’esprit pour réussir dans un monde en pleine mutation.
Parcours et premières expériences avec la Russie et l’Asie centrale
“De Moscou à Saint-Pétersbourg : ma rencontre avec le monde russophone”
-Dans votre parcours, on voit un fort lien avec le Kazakhstan et l’Asie centrale. Pourquoi ces régions en particulier ? Est-ce un choix personnel lié à votre intérêt, une spécialisation professionnelle, ou bien une mission confiée par votre gouvernement ?
-Alors, je vais peut-être commencer par expliquer comment j’ai découvert les pays russophones. J’ai toujours eu une fascination pour la Russie, déjà à l’époque soviétique. En 1984, avec mon père, nous avons décidé de passer Noël là-bas. Nous avons visité Moscou et Saint-Pétersbourg, assisté à des représentations au Bolchoï et au Mariinsky. Pour moi, ce fut une révélation, une véritable découverte culturelle.
Ensuite, j’ai continué à m’intéresser à cette région, à sa culture, sa littérature, sa musique. Et au début des années 1990, avec la perestroïka et les privatisations, mon domaine — la finance — trouvait là un terrain d’opportunités. Nous avons participé aux privatisations d’entreprises russes, notamment via le trading des vouchers. C’était une période passionnante mais aussi très “sauvage”, où il fallait parfois se déplacer avec des gardes du corps. Jusqu’à la crise de 1998, nous avons beaucoup travaillé en Russie.
Après la crise, alors que beaucoup quittaient le pays, j’ai eu au contraire la conviction que c’était le moment d’y rester. En 2002, j’ai donc ouvert un bureau à Saint-Pétersbourg pour accompagner les banques, les assurances, les entreprises européennes qui voulaient s’implanter en Russie, mais aussi pour aider les Russes à s’installer en Suisse. Nous organisions même des conférences pour promouvoir la Suisse.
C’est dans ce contexte qu’en 2009, j’ai rencontré mon partenaire Nikolai Karpenko. Ensemble, nous avons fondé Hercules Partners, un family office destiné à accompagner des clients russes fortunés en Suisse.
En parallèle, je me suis impliqué dans la Joint Chamber of Commerce Suisse-Russie, qui couvre aussi l’Asie centrale et le Caucase du Sud. C’est d’ailleurs par ce biais que j’ai été approché par l’ambassadrice du Kazakhstan à Genève. Elle m’a demandé si je serais intéressé à devenir consul honoraire de son pays. Pour moi, ce fut une évidence : j’adore l’Asie centrale, sa culture, son potentiel, et j’ai accepté avec grand plaisir.
Cela fait maintenant environ huit ans que je suis consul honoraire du Kazakhstan. Je travaille en lien étroit avec l’ambassadeur et nous développons activement les relations entre nos deux pays. La Suisse est aujourd’hui le troisième partenaire commercial du Kazakhstan, avec de nombreuses entreprises suisses installées sur place.
Le Kazakhstan a d’ailleurs une avance certaine sur ses voisins. Ils ont créé un centre financier inspiré du Dubai International Financial Center, qui attire des acteurs majeurs comme Goldman Sachs, mais aussi les Chinois, et qui s’ouvre aux crypto-monnaies et aux fonds d’investissement. Avec la Nouvelle Route de la Soie (Silk Road), cette région représente pour la Suisse et pour l’Europe une opportunité stratégique absolument majeure.

Développement professionnel et opportunités dans les pays ex-soviétiques
“Privatisations, crises et family office : la Russie comme école de la réussite”
-Donc vos activités s’ouvrent ici, ou vous vous déplacez ?
-Bien sûr, je me déplace. Je vais deux ou trois fois par an au Kazakhstan, pour participer à des conférences ou rencontrer des partenaires. C’est un pays que j’aime vraiment beaucoup, tout comme l’Asie centrale en général. J’ai d’ailleurs eu la chance d’être invité par le conseiller fédéral Schneider-Ammann il y a quelques années pour un voyage officiel d’une semaine. Nous avons visité l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, puis de nouveau le Kazakhstan. C’était passionnant, et cela m’a confirmé l’importance stratégique de cette région pour la Suisse, en particulier le Kazakhstan.
-Vous avez connu l’URSS de près. Comment c’était pour vous avant sa chute ?
-La première fois que j’y suis allé, en 1984, le pays était encore très fermé. Nous avions toujours une guide attitrée, à Moscou comme à Saint-Pétersbourg, qui parlait français. J’ai quelques anecdotes marquantes. Par exemple, avec mon père à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), nous logions dans un hôtel construit pour les Jeux olympiques. Un soir, nous avons voulu sortir pour boire un café, mais après avoir marché plusieurs kilomètres, nous n’avons rien trouvé. De retour à l’hôtel, il était à peine 21h et tout était déjà fermé. Cela donne une idée de l’ambiance : assez triste, assez gris.
À partir de 1991, les choses ont commencé à changer, mais c’est surtout au début des années 2000 que la transformation s’est vraiment ressentie.
-Et selon vous, la principale raison de la chute de l’URSS, c’était quoi ?
-Simplement la fin d’un système qui ne fonctionnait plus. L’Union soviétique était en faillite, exsangue sur le plan économique. Les revenus ne suffisaient plus à faire tourner le pays. Il fallait un changement. Gorbatchev a ouvert la voie, puis la chute du Mur de Berlin a accéléré le processus, avec aussi une forte pression et une attente de l’Occident.
-Moi j’ai de la nostalgie pour l’URSS, car j’avais 20 ans quand elle est tombée. Mais il y avait aussi des bonnes choses, comme l’éducation, non ?
-Absolument, il y avait des choses magnifiques. Lorsque j’ai ouvert mon bureau en Russie, j’ai travaillé avec des collaboratrices d’un niveau exceptionnel. Je me souviens d’une femme d’une cinquantaine d’années : elle parlait parfaitement le français et l’anglais, mais aussi le polonais, et avait une culture impressionnante. C’est elle qui m’a initié à la vie culturelle locale : l’opéra, le ballet, le théâtre…
Je lui disais : “Svetlana, cela ne sert à rien de m’amener au théâtre, je ne comprends pas la langue !” Et elle me répondait toujours : “Jean-Paul, regarde la gestuelle, tu comprendras.” Et c’était vrai : même sans parler russe, je suivais parfaitement l’intrigue.
J’étais aussi frappé par le niveau d’éducation en général. Dans le métro, tout le monde lisait. La musique, la littérature, la culture faisaient partie du quotidien. En comparaison, en Suisse, ce n’est pas du tout pareil. Quand je voyais les enfants russes de l’époque et les compare aux miens, il y avait une énorme différence dans l’éducation et la formation culturelle.
-Donc la première fois, vous avez eu un vrai choc culturel ?
-Oui, sans aucun doute. Pour vous donner un exemple, en arrivant à Moscou en 1984, les douaniers ont fouillé mes bagages et confisqué un magazine Géo
que j’avais emporté… parce qu’il contenait un dossier sur la Russie ! Ils m’ont dit : “Vous le récupérerez à Saint-Pétersbourg.” Et effectivement, en repartant de là-bas, ils me l’ont rendu.
C’était un vrai choc culturel, bien sûr, mais un choc passionnant. On n’avait pas la liberté que nous connaissions en Europe : on était suivi par une guide, on nous déconseillait de nous promener seuls. Mais malgré cela, j’ai vécu ce séjour comme une découverte extraordinaire.
Le rôle diplomatique et les liens avec le Kazakhstan
“Consul honoraire et pont entre la Suisse et l’Asie centrale”
-Vous connaissez bien l’Asie centrale. Voyez-vous aujourd’hui des différences marquantes entre les Kazakhs, les Kyrgyz et les Ouzbeks, par exemple ?
-La principale différence, c’est l’économie. Le Kazakhstan est en plein boom, c’est incroyable. Le président Tokayev progresse dans le sens de la démocratie, lutte contre la corruption, et la qualité de vie, l’éducation et la santé s’améliorent réellement. L’Ouzbékistan est aussi très intéressant : avec ses 36 millions d’habitants, il a un énorme potentiel de développement économique. Le Kirghizstan, lui, est plus petit et présente moins d’attrait pour les investisseurs, faute de ressources visibles. Le Tadjikistan et le Turkménistan restent compliqués. Pour nous, les deux pôles principaux sont le Kazakhstan et l’Ouzbékistan.
-Avez-vous appris quelques mots des langues locales ?
-Non, mais je parle russe. Je ne le maîtrise pas parfaitement, mais je me débrouille, ça me suffit pour communiquer.
-Aujourd’hui en Asie centrale, quelle influence vous semble la plus forte : Russie ou Chine ? Et comment les populations locales perçoivent-elles cette dualité ?
-Au Kazakhstan, la Chine est un partenaire stratégique. Elle finance beaucoup d’infrastructures : routes, aéroports, chemins de fer. Le Kazakhstan est un passage clé pour le commerce chinois. La Russie reste cependant le « grand frère » avec lequel la frontière est énorme et les liens historiques forts. Même avec le contexte actuel, les contacts entre Poutine et Tokayev restent constants. Pour moi, Chine et Russie sont les partenaires principaux, mais l’Europe gagne aussi en importance.
-Et les États-Unis, leur influence est-elle forte ?
-Oui, ils sont intéressés et actifs via de grandes chambres de commerce et participations dans certains projets financiers, comme l’Astana International Financial Center. Mais géographiquement, ils sont loin. Pour le Kazakhstan, la priorité reste la Chine et la Russie.
Économie, technologie et perspectives pour l’Asie centrale
“Kazakhstan et Ouzbékistan : des terres d’opportunités et d’innovation”
-Et l’Europe, surtout après la guerre en Ukraine, semble s’intéresser davantage à l’Asie centrale ?
-Oui, c’est une réalité. Beaucoup d’entreprises suisses ont délocalisé leur activité de Russie vers le Kazakhstan, comme Stadler Rail, fabricant de trains. Le Kazakhstan est devenu une sorte d’arrière-garde pour ces opérations. La Suisse est le troisième investisseur du pays, ce qui est très significatif pour un petit pays comme le nôtre. Les liens entre Genève et Astana sont solides, et le président Tokayev connaît bien notre pays.
-Vous parliez des opportunités, mais il y a aussi des défis. Les avez-vous identifiés ?
-Travailler dans la région devient plus simple. La corruption est encore présente dans certains pays, mais dans mes affaires au Kazakhstan, je n’ai jamais été confronté à un problème majeur. En Ouzbékistan, nous avons participé à des privatisations et tout s’est déroulé normalement.
Bien sûr, il reste des difficultés administratives héritées de l’époque soviétique. Mais la nouvelle génération, âgée de 35-40 ans, éduquée à l’étranger, a une vision différente. Ces jeunes veulent développer leur pays et ne pensent pas à la corruption. Dans les 20 dernières années, l’Asie centrale a beaucoup changé grâce à eux. C’est avec ces personnes que l’on peut vraiment travailler.
Selon vous, y a-t-il des différences de mentalité entre les Tadjiks, les Kirghiz, les Kazakhs et les Ouzbeks ?
-Oui, il y a clairement des différences, surtout liées à l’éducation. Les personnes qui ont étudié à l’étranger ou dans des universités internationales ont une ouverture d’esprit beaucoup plus large. Par exemple, à l’université de Saint-Gall, certains étudiants d’Asie centrale parlent suisse-allemand et ont une vision internationale. Cela change profondément les mentalités. À l’inverse, quelqu’un qui n’a connu que son pays, même avec des études locales, reste plus limité dans sa perspective. Le Kazakhstan est en tête en termes d’ouverture, suivi par l’Ouzbékistan.
-Quelles traditions du Kazakhstan appréciez-vous particulièrement ?
-Ce que j’admire, c’est cet esprit nomade qui perdure. Les Kazakhs aiment toujours les chevaux, la chasse, et passer du temps dans les yourtes. Même les habitants des villes, riches ou urbains, conservent ces traditions le week-end : ils pêchent, chassent, vivent au rythme de leurs racines. Cette continuité culturelle, malgré la modernisation, est très précieuse à mes yeux.
-Qu’est-ce qui distingue un entrepreneur d’Asie centrale d’un entrepreneur européen ou américain ?
-En Europe, l’approche est très pragmatique. Les Américains, eux, sont plus audacieux : faire faillite ne porte pas atteinte à leur réputation. Les entrepreneurs d’Asie centrale, eux, cherchent avant tout la durabilité. Ils veulent construire quelque chose qui dure dans le temps, plutôt que de prendre des risques extrêmes pour un gain rapide.
Culture, traditions et mentalité des peuples d’Asie centrale
“Nomades et modernes : comprendre l’âme des Kazakhs, Ouzbeks et Kyrgyz”
-Et concernant l’islam et l’islamisation dans la région, avez-vous des observations ?
-Tout dépend du pays. Au Tadjikistan ou au Turkménistan, la situation est plus complexe. Ce que j’apprécie au Kazakhstan, c’est la réelle liberté de religion : mosquées, synagogues, églises catholiques et orthodoxes coexistent. Le président Tokayev encourage même des conférences interreligieuses. Pour moi, c’est un signe fort de démocratie et de laïcité. Tant que l’islam reste modéré et que les autorités veillent à prévenir l’extrémisme, il n’y a pas de problème.
-Personnellement, selon vous, à quel point la religion doit-elle être présente dans notre vie quotidienne ?
-Écoutez, nous avons la liberté de religion. Moi, je suis catholique, je vais à l’église et, pour moi, la religion est importante. Mais je pense que chacun doit décider pour soi-même. On ne doit pas imposer une religion à qui que ce soit : c’est une décision personnelle. La laïcité joue ici un rôle essentiel.
Comme vous le mentionnez, au Kirghizstan, environ 80 % des habitants sont de confession musulmane. S’ils souhaitent pratiquer leur religion, qu’ils le fassent. Ce qui compte, c’est que cela ne bascule pas dans l’extrémisme.
La religion fait partie de la vie quotidienne, même en Europe : il n’y a pas un village sans son église. À côté de chez nous, il y a aussi une synagogue. Cela montre que la diversité religieuse existe et peut coexister.
Je crois donc qu’il faut une grande liberté d’esprit, mais jamais d’extrémisme, dans aucun domaine. Malheureusement, il y a encore des dictatures dans le monde, et c’est triste. La démocratie, elle aussi, s’applique à la liberté religieuse.
-En Asie centrale, depuis la chute de l’URSS, on observe une sorte de division des visions du monde : certains peuples sont encore influencés par la russification, d’autres se tournent vers le modèle religieux venu du Moyen-Orient, et d’autres encore s’inspirent de l’Occident. Avez-vous remarqué ce phénomène, et comment l’interprétez-vous ?
Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Prenons l’exemple du Kazakhstan, que je connais un peu mieux : lorsque les politiciens se réunissent, ils s’expriment officiellement en kazakh, mais une fois la réunion terminée, ils repassent immédiatement au russe. Cela montre à quel point le russe reste profondément implanté dans les familles et dans la vie quotidienne.
Si l’on parle maintenant de l’Occident, je me souviens que, lorsque j’étais jeune, mon rêve était d’aller en Amérique. Plus tard, j’ai eu la chance d’y étudier. À l’époque, les États-Unis représentaient non seulement un rêve, mais aussi un modèle éducatif et scientifique, car ils avaient une avance considérable dans plusieurs domaines. Forcément, quand on grandit en regardant la télévision et qu’on voit ce qui se passe aux États-Unis, cela donne envie.
En même temps, les racines soviétiques restent très présentes. Même aujourd’hui, beaucoup d’enfants continuent de parler russe avec leurs parents, plutôt que leur langue nationale – que ce soit le kazakh, l’ouzbek ou le kirghiz. Il existe une volonté politique et culturelle de revenir aux langues nationales, mais c’est un processus complexe. Le « grand frère » russe reste toujours là, et les habitudes linguistiques sont profondément ancrées.
Pour être honnête, lorsque je me rends au Kazakhstan, je constate que la langue réellement dominante dans la vie quotidienne, ce n’est pas le kazakh, mais bien le russe.
-Et si l’on parle maintenant de la liberté d’expression : avez-vous des observations à ce sujet ? Selon vous, dans quel pays d’Asie centrale cette liberté est-elle la plus présente aujourd’hui ?
Au Kazakhstan, il me semble qu’il y a un peu plus de liberté d’expression que dans les autres pays de la région. Mais cela reste tout de même un problème, et pas un problème qui pourra être réglé facilement. D’une manière générale, dans toute l’Asie centrale, mais aussi dans le Caucase du Sud, la liberté d’expression existe, mais elle connaît de fortes limites.
Atteindre un niveau comparable à celui que nous avons en Suisse prendra, à mon avis, encore beaucoup de temps.
-Quels sont aujourd'hui les secteurs dans lesquels vous investiriez sans hésitation ?
Bien sûr, certains secteurs connaissent une croissance particulièrement forte. Au Kazakhstan, par exemple, on observe de grands progrès dans la construction et surtout dans le domaine des technologies de l’information. Le centre financier qui s’y développe avance de manière spectaculaire, et les nouvelles technologies occupent une place de plus en plus importante : intelligence artificielle, crypto-monnaies, blockchain… La blockchain est d’ailleurs déjà appliquée concrètement, notamment pour le suivi des containers traversant l’Asie centrale : chaque container est équipé de puces, ce qui permet de savoir en temps réel où il se trouve et quelle marchandise il transporte. Ce sont donc des domaines qui attirent de nombreux investissements.
En Ouzbékistan également, le secteur de la construction est en plein essor. Les infrastructures doivent être modernisées, et cela crée d’énormes opportunités. Lorsque j’étais à Tachkent avec mon partenaire, il y a deux ou trois ans, nous avons rencontré de nombreux entrepreneurs russes venus de Moscou. Comme le marché de la construction en Russie ralentissait, ils ont choisi de s’installer en Ouzbékistan, où le secteur est réellement en pleine explosion. Il suffit de voir l’évolution de villes comme Tachkent ou Samarcande pour mesurer à quel point la transformation est impressionnante.
-Si un jeune entrepreneur de l'Asie centrale venait vous voir avec un projet, quels critères regarderiez-vous en priorité avant d'investir ?
Avant tout, il faut qu’un business plan soit bien fait — et croyez-moi, c’est un vrai problème. Quand je travaillais en Russie, notamment avec l’Académie des sciences, j’ai vu de nombreux projets, mais nous n’avons jamais réussi à obtenir un business plan vraiment sérieux.
Donc, la première étape essentielle, c’est d’avoir un plan solide et réaliste. Ensuite, il faut que la personne qui porte le projet, ainsi que son équipe, soient crédibles et engagés. Bien sûr, on prendra aussi des références, mais l’essentiel, c’est de voir que le projet est intéressant et que son business plan tient la route.
À partir de là, on peut discuter de tout le reste. Mais la base, le point de départ indispensable, c’est un business plan clair et bien construit.
-Quelle a été la plus grande leçon de votre carrière que vous aimeriez transmettre à un jeune entrepreneur ou à un réfugié qui démarre de zéro ?
-Ce que j’ai appris au fil des années, notamment en travaillant avec les pays de l’ex-URSS, c’est qu’il ne faut jamais partir du principe que les autres pensent comme nous. C’est une erreur que j’ai souvent commise en Russie : parce qu’ils me ressemblaient physiquement, je croyais qu’ils avaient la même mentalité. Mais en réalité, nous étions très différents, avec des critères, des repères et des façons de penser qui ne coïncidaient pas.
La grande leçon que j’en ai tirée, c’est l’importance d’écouter vraiment l’autre. Comprendre qu’il est différent, qu’il a une vision propre, et prendre le temps de découvrir cette vision. Au début, on peut être aux antipodes, mais petit à petit, en s’écoutant et en se comprenant, on peut construire quelque chose ensemble.
Pour moi, c’est la clé : la compréhension mutuelle. C’est seulement en acceptant nos différences et en apprenant à se comprendre que l’on peut réussir à créer quelque chose de solide et de durable.
C’est d’abord d’être à l’écoute de l’autre. Vraiment. Être attentif à ce qu’il veut, à ce qu’il exprime, et chercher à créer une véritable osmose entre deux personnes. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus à l’écoute que je ne l’étais auparavant. Quand j’étais plus jeune, j’étais peut-être un peu plus sauvage, moins patient. Mais avec le temps, j’ai appris à aller plus profondément dans la compréhension de l’autre. Et pour moi, c’est une richesse essentielle.
Philosophie de vie, engagement et vision du monde
“Sagesse, engagement et liberté : le sens de la vie et du travail”
Si vous deviez résumer en une phrase votre philosophie de la vie et de travail, quelle serait-elle ?
-Ma philosophie de vie, c’est avant tout de découvrir de nouveaux pays. Depuis 40 ans, je me suis beaucoup investi dans les pays russophones, que j’aime profondément, parce que j’apprécie cette culture et ces gens. J’aimerais passer encore plus de temps en Asie centrale ou en Russie. Bien sûr, j’ai aussi mes affaires à gérer, et elles sont depuis longtemps liées à ces régions, mais pour moi c’est bien plus qu’un travail : c’est une passion.
Je me considère heureux d’avoir connu l’Union soviétique à l’époque, d’y avoir développé mes affaires et d’avoir construit des liens durables. J’aime ces peuples, je les trouve absolument remarquables, et je souhaite continuer à collaborer avec eux.
Je pense aussi qu’un jeune doit se fixer un objectif. Aujourd’hui, beaucoup se tournent vers les États-Unis : c’est un chemin plus simple pour étudier, peut-être pas forcément pour faire des affaires, mais cela reste une porte ouverte. L’important, à mes yeux, c’est que, au-delà du business, il y ait aussi un intérêt culturel et intellectuel. Car c’est cela qui nourrit réellement une vie.
-Je vois que vous êtes très attaché aux pays russophones. Est-ce que cela rend la guerre actuelle encore plus difficile et douloureuse pour vous ?
-Bien sûr, je suis profondément attristé par ce conflit, par cette guerre. J’aimerais qu’elle s’arrête avant tout pour des raisons humanitaires, car ce gâchis, cette boucherie, est intolérable. C’est une immense tristesse.
Je ne donnerai pas d’opinion politique sur ce conflit, ce n’est pas mon rôle. Ce que je peux dire, c’est que les Russes restent mes amis, les Ukrainiens aussi. Ils sont d’ailleurs membres de notre chambre de commerce.
Mon souhait le plus cher, c’est que la guerre prenne fin, afin que l’on puisse à nouveau voyager librement, que ce soit en Russie ou en Ukraine, et retrouver des pays en paix.
-Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui, après une carrière si riche ?
-J’ai toujours la même passion qu’à 30 ou 40 ans. Mon travail, mes différentes activités me motivent encore énormément. J’espère pouvoir continuer longtemps, si Dieu me donne la force. En réalité, ce qui me porte, c’est simplement que j’aime profondément ce que je fais.
-Est-ce que la mondialisation rapproche vraiment les peuples, ou bien les uniformise-t-elle ?
-La mondialisation rapproche évidemment les peuples, mais elle comporte aussi des dangers. On le voit avec la question des réfugiés : la mondialisation, c’est avant tout la mobilité, le déplacement de populations d’un endroit à un autre. Or, beaucoup de pays deviennent de plus en plus restrictifs face à ces mouvements. Donc, oui, la mondialisation est un phénomène normal et nécessaire, mais elle a aussi ses risques.
-Moi, je vois aussi la mondialisation comme un énorme bulldozer, qui écrase beaucoup de cultures. Même de grandes civilisations comme le Japon ou la Chine risquent, à mes yeux, d’être menacées par cette uniformisation.
-C’est vrai, mais il y a des nuances. Le Japon, par exemple, reste très fermé à l’immigration. Les Japonais gardent ainsi leurs traditions, car la proportion d’étrangers y est extrêmement faible. La Chine, elle, a d’autres enjeux. J’y étais l’an dernier avec mon partenaire, nous avons visité des grandes entreprises comme Alibaba ou BYD : c’est un pays en plein mouvement, qui a besoin de la mondialisation pour écouler ses marchandises. Mais là encore, on ne trouve pas énormément d’étrangers qui y travaillent.
Il faut dire que la mondialisation, ce n’est pas seulement un brassage de populations : c’est surtout le commerce international. Et cela crée de fortes tensions, on le voit notamment aux États-Unis, avec les déséquilibres de la balance commerciale et les conflits autour des taxes douanières.
-Qu’est-ce qui, selon vous, donne du sens à la vie d’un homme : sa liberté, son engagement ou son héritage ?
-Son engagement. Si un homme n’a pas de but dans la vie, quel qu’il soit, et qu’il n’essaie pas de l’atteindre, il finit par être malheureux. L’engagement donne une direction, une raison d’avancer. Mais il doit être profond, total, presque existentiel. Sans engagement, la vie perd de sa substance.
-Pensez-vous que l’histoire humaine avance réellement par le progrès, ou bien qu’elle répète toujours les mêmes erreurs ?
-Je pense que nous avançons grâce au progrès. Ce que nous avons vécu avec l’Internet, le Wi-Fi, et maintenant l’intelligence artificielle est absolument extraordinaire. Dans mon domaine, nous utilisons beaucoup l’IA, et elle nous fait progresser dans des directions que l’homme, seul, n’aurait sans doute jamais imaginées.
Bien sûr, il existe des risques. Mais je crois qu’il faut garder une vision positive : ces changements doivent être perçus comme des opportunités pour l’humanité. Il y aura toujours des laissés-pour-compte, c’est vrai, mais l’évolution reste indispensable. Les traditions sont importantes et doivent être préservées, mais le mouvement, le progrès, sont tout aussi essentiels pour que l’humanité continue à grandir.
-Selon vous, la culture peut-elle réellement changer le destin d’un peuple ?
-Je ne le crois pas. La culture est extrêmement importante, elle nourrit l’âme, elle façonne l’identité, mais je ne pense pas qu’elle puisse, à elle seule, transformer le destin d’un peuple. Aujourd’hui, ce sont surtout les évolutions technologiques qui bouleversent le monde et redéfinissent nos sociétés.
-Même la grande littérature, le théâtre ou l’art n’ont donc pas d’influence sur les guerres ou sur les grands bouleversements de l’histoire ?
-Non, pas directement. Bien sûr, l’être humain a besoin de culture : aller au théâtre, à l’opéra, à un concert, lire de bons livres… tout cela est essentiel pour son développement personnel et son équilibre. Malheureusement, on le fait de moins en moins, parfois aussi parce que cela coûte cher. Mais aussi précieux qu’ils soient, ces apports culturels ne suffisent pas à empêcher les guerres ni à orienter les grandes décisions du monde. La culture enrichit les individus, mais ce sont la technologie, l’économie et la politique qui mènent les grandes transformations.
-Est-ce que vous-même, vous écrivez ?
-Non, je n’écris pas. En revanche, je lis énormément, surtout des ouvrages liés au monde russophone et à la géopolitique. Je trouve que c’est un domaine essentiel pour comprendre l’évolution du monde. En ce moment, je m’intéresse beaucoup à l’Arctique : un sujet crucial non seulement pour la Russie, mais aussi pour l’Asie centrale, la Chine, les États-Unis et l’Europe. Mon regard, mon intérêt, restent toujours tournés vers l’Est.
-C’est dommage que vous n’écriviez pas, parce que vous avez une expérience de vie très riche. Vous pourriez beaucoup apporter en partageant vos réflexions, par exemple à travers des articles ou des entretiens avec des journalistes.
-Peut-être… Mais pour moi, lire reste un véritable plaisir, presque un besoin. Je prends beaucoup de plaisir à relire Dostoïevski, Tolstoï… Ma compagne lit Tolstoï en ce moment. J’aime aussi les biographies, ou encore me plonger dans l’histoire des révolutions. Hier par exemple, j’écoutais un podcast sur Bakounine, ce grand révolutionnaire anarchiste. J’aime revisiter ces périodes, car même si on lit beaucoup, on oublie aussi beaucoup. Relire, réécouter, se replonger, c’est une manière de garder vivante cette mémoire.
Et je crois profondément que l’être humain doit toujours avoir un objectif, une passion. Il doit chercher à réussir dans ce qu’il aime vraiment, mais en allant en profondeur. On ne réussit pas dans la superficialité : il faut s’engager, se plonger complètement dans ses projets. C’est pour moi une règle de vie essentielle.

-On dit souvent que l’Orient incarne la sagesse et l’Occident l’éducation. Partagez-vous cette idée ?
-Vous savez, moi je crois que la sagesse ne se limite pas à l’Orient. J’ai eu la chance d’en recevoir aussi très tôt, grâce à mon éducation et à ma famille. Je viens d’une famille nombreuse, nous étions sept enfants. Ma grand-mère vivait avec nous, nous étions toujours dix à table, et chaque semaine le curé venait dîner à la maison. Cette ambiance familiale, ces repères religieux, m’ont donné une certaine sagesse et une direction dans la vie, qui m’ont peut-être évité bien des erreurs.
Alors bien sûr, on parle souvent de la sagesse orientale, et c’est vrai qu’elle existe. Mais je crois qu’on peut être sage partout, selon le contexte dans lequel on vit. En Suisse, par exemple, c’est peut-être plus simple : nous avons une qualité de vie extraordinaire, l’éducation, la santé, la stabilité… cela crée un cadre propice à la réflexion. Dans d’autres régions, comme en Afrique, la vie est plus tournée vers la survie, et la sagesse prend une autre forme. Aux États-Unis, c’est encore différent, un peu plus “sauvage”.
Donc je dirais qu’il y a de la sagesse des deux côtés, Orient et Occident. Simplement, elle s’exprime de manière différente.
Zhenishbek EDIGEEV